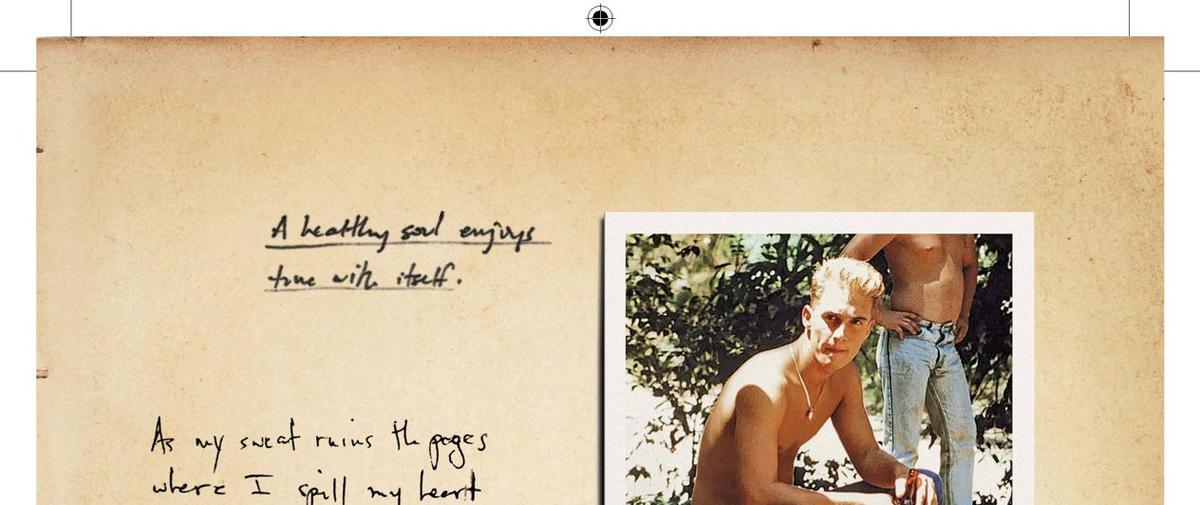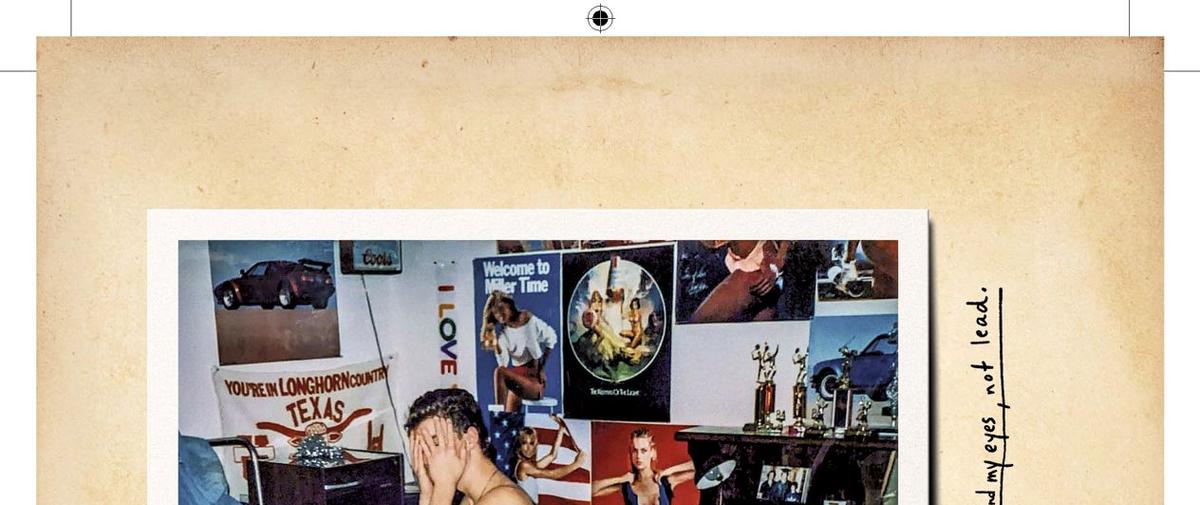Interview.- On connaissait l’acteur, star oscarisée de Dallas Buyers Club, voici l’homme mis à nu dans son autobiographie. Juste avant la sortie en France de Greenlights, il partage avec nous les leçons tirées d’une vie à hauts risques.
Il apparaît pile à l’heure sur l’écran Zoom, et sans filtre, dans tous les sens du terme. Ni attaché de presse ni agent, juste Matthew McConaughey, en direct de sa maison d’Austin, Texas. Ses yeux bleus, son teint hâlé, ses cheveux blonds crantés gominés en arrière, son sourire, dont il n’est pas avare, et son «plaisir» – c’est son mot – à discuter près de deux heures, à enchaîner souvenirs d’enfance, blagues, anecdotes de carrière, potacheries et réflexions très sérieuses sur le sens de la vie. Dans le petit monde de Hollywood, le mot «rare» n’est pas suffisant pour qualifier ce genre d’interview. Mais l’acteur de 51 ans a l’habitude de sortir du lot. «Marginal au cœur du système», comme il aime à se définir, il est l’homme de toutes les transformations.
Révélé en 1993 par le devenu culte Génération rebelle (Dazed and Confused), immédiatement enrôlé par les plus grands réalisateurs (Spielberg, Zemeckis…), encensé par les critiques, il déçoit dix ans plus tard en enchaînant les comédies romantiques, devient playboy accro au bodybuilding et au jogging torse nu sur la plage. Tournant 2010, il se métamorphose à nouveau, avec plusieurs films indépendants de haute tenue, La Défense Lincoln ouvrant le bal. Pour interpréter le cow-boy séropositif de Dallas Buyers Club, il perd 20 kilos, méconnaissable, et remporte l’Oscar du meilleur acteur.
Aujourd’hui, c’est encore autre chose. Matthew McConaughey a écrit un livre, une autobiographie (1) qu’il n’hésite pas à nommer sa «plus importante œuvre d’art». Il le dit en riant, mais insiste sur le fait qu’il le pense vraiment. Publié il y a un an en anglais, aujourd’hui disponible en français, Greenlights s’est déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires, en tête des listes des best-sellers aux États-Unis. La recette de ce succès ? Des extraits de journaux intimes écrits depuis ses 15 ans, une matière première – sa vie – riche en événements, de l’humour et une philosophie positive, l’idée générale étant de raconter comment il a œuvré à transformer les déconvenues (feux rouges) en opportunités (feux verts). Mais, surtout, une honnêteté et une générosité qui font de ce récit autobiographique un délicieux ovni, l’auteur n’hésitant pas à dépeindre d’une même candeur les épisodes les plus glorieux comme les plus embarrassants. Un exercice qu’il réitère en condensé, face à la caméra de son ordinateur, sans se faire prier, c’est un euphémisme.
Madame Figaro. – Dans Greenlights, vous partagez des souvenirs intimes parfois très durs, comme une bagarre au couteau entre vos parents sous vos yeux d’enfant de 4 ans… Avez-vous hésité à raconter ces moments ?
Matthew McConaughey. – Pas une seconde. Beaucoup de lecteurs m’ont dit que c’était inhabituel, pour un acteur de Hollywood, de se livrer de cette manière-là. Les gens utilisent le terme «vulnérabilité»… Pourtant, ces histoires n’ont pas été plus difficiles à écrire que celles où je parle de ma carrière, de mes succès. Elles font partie de ma vie. La laideur est aussi importante que la beauté, la douleur aussi importante que le plaisir. Et puis, je ne juge pas.
Lorsque l’on commence à lire un passage comme celui que vous citez, mon père et ma mère s’affrontant avec un couteau, le sang…, on se dit, bon, c’est le moment où tout va s’effondrer : le couple, la famille, les enfants. Et non, le combat se termine et mes parents font l’amour sur le sol de la cuisine. L’amour triomphe. Oui, mon père et ma mère ont divorcé deux fois. Mais ils se sont mariés trois fois. Toujours l’un avec l’autre.
Enfant, vous aviez conscience que vos parents avaient une relation si particulière ?
J’étais petit, je ne connaissais que ce modèle. Bien sûr, je savais qu’ils avaient un lien passionnel. Je savais qu’il y avait beaucoup de larmes à la maison, mais des larmes de joie bien plus que de tristesse ou de douleur. Ma mère, en lisant le livre, m’a dit : «Matthew, ces histoires sont vraies, mais pourquoi n’as-tu pas choisi plutôt celles qui montrent l’amour, la tendresse, le respect mutuel ?» Elle a raison, 95 % de mon enfance n’était qu’amour et joie. Je pense que si, malgré cela, j’ai raconté les épisodes difficiles, c’est parce que ce sont ceux où l’amour, justement, était testé, mis en péril. Et que, même à 4 ans, je n’avais aucun doute : je savais que ces drames se termineraient bien, qu’on allait tous finir par se prendre dans les bras. Il n’y avait jamais de rancœur, on en riait dès le lendemain. C’est ma famille. Nous sommes comme ça. On parle d’un «incident» pour ce que d’autres appellent une «catastrophe». On dit «Ça chatouille», là où les autres disent «Ça fait mal».
Votre mère vous a quand même jeté dans les rapides d’une rivière, près d’une chute d’eau, pour vous apprendre à nager…
Oui ! (Il rit.) J’en parlais justement avec elle l’an dernier, on était en vacances à côté de cette rivière, elle m’a dit : «Tu te souviens, c’est là où je t’ai jeté.» Je lui ai demandé : «Mais tu savais que je réussirais à nager ?» Elle m’a répondu : «Eh bien, je t’en croyais capable. Et tu l’as fait ! Donc j’avais raison !» Mes parents étaient ainsi. Ils nous montraient qu’on pouvait relever des défis bien avant qu’on en ait conscience nous-même. Mon père croyait beaucoup aux rites de passage. Mes deux grands frères ont eu le leur. Le mien, non planifié, s’est passé le jour où un vigile, à la sortie d’un restaurant, a posé ses deux mains sur le torse de mon père, en grondant : «Vous n’avez pas payé !» Bien sûr que si, on avait payé, et ça aurait pu se régler tranquillement. Mais j’ai vu rouge, j’ai sauté sur le vigile, je l’ai renversé sur une table. Mon père m’a calmé, tout en étant très fier. Pas que je me batte, non. Que je sois prêt à prendre un risque, à avoir mal, à être blessé, pour ce qui me tient à cœur. Que je sois prêt à m’engager dans un combat, où, très clairement, je risquais de perdre.
Est-ce que cette éducation «dure au mal» vous a servi dans votre carrière ?
Énormément. Mes parents m’ont appris la persévérance, l’endurance et la résilience. Ça m’a permis d’affronter les refus, les déceptions, et de continuer à me battre pour ce que je voulais. Et puis, ça m’a donné un grand sens de l’humour. Être capable de rire de ses propres échecs, et d’accepter que les autres en rient. Là où certains diraient : « Non, s’il te plaît, ne te moque pas, c’est trop tôt, je suis blessé et la plaie saigne encore», moi je dis : « Hey, autant en rire tout de suite, parce que de toute façon, c’est fait. J’ai fait n’importe quoi, on ne pourra pas l’effacer, alors rions-en, ça nous aidera à aller de l’avant.» Bien sûr, une éducation comme celle-ci, aujourd’hui, ne passerait pas. Et ce n’est pas celle que je donne à mes enfants. Mais j’essaie de leur transmettre les mêmes valeurs. De leur donner confiance en eux. Mes trois enfants (une fille de 11 ans, deux garçons de 13 et 8 ans qu’il élève avec sa femme, Camila, NDLR) font du surf. Ils se débrouillent bien, ils progressent peu à peu, en prenant des vagues de plus en plus hautes. Qui je serais, moi, pour leur crier depuis la plage «Non, pas celle-là, elle est trop haute !», et leur inculquer ainsi la peur. Ils savent mieux que moi. Surprotéger ses enfants n’est pas un service à leur rendre : la vie, ensuite, n’est pas comme ça.
Au début du livre, vous écrivez que vous avez été agressé sexuellement par un homme à l’âge de 18 ans, mais ne dites rien des circonstances et des conséquences. Pourquoi ?
C’est juste une phrase dans un paragraphe. Et une autre courte phrase explique que j’ai été contraint par chantage à avoir mes premières relations sexuelles à 15 ans, ce qui n’était pas non plus une bonne expérience. Je ne voulais pas donner de détails. J’aurais pu le faire, ce sont des histoires que je n’ai aucun mal à raconter. Mais je sais comment les médias fonctionnent. Cela aurait fait les gros titres : Matthew McConaughey agressé sexuellement. On aurait transformé les gens en voyeurs, encore une fois. Et éclipsé le reste du livre, ces histoires que je raconte sur le fait de prendre des risques ou de s’engager plutôt que de se laisser effrayer, plus personne ne les auraient écoutées. Le dire brièvement au début, et enchaîner sur le reste de ma vie, c’est dire au lecteur : est-ce qu’on a fait de moi une victime ? Oui. Est-ce que j’ai choisi de rester une victime ? Non.
« Victime, moi, jamais ! »
Vous ne vous êtes jamais identifié au statut de victime ?
Jamais. Il n’était pas question que ces expériences cauchemardesques, ces injustices subies, me définissent. Je ne les aurais pas laissées me faire ça. Quand j’utilise le terme «feux verts» dans le livre, je sais qu’il y a aussi des feux rouges inévitables, qu’on n’a pas d’autre choix que de s’y arrêter. Et qu’on a besoin de prendre ce temps, sinon, comment progresser, évoluer ? Mais, parfois, c’est la nature humaine, on a tendance à développer une addiction aux feux rouges. On est là, assis, et on se dit non, je ne redémarre pas. Parce que ça semble plus facile, plus confortable à ce moment-là. Il faut faire attention. Les feux rouges attirent d’autres feux rouges. Ils s’accumulent. Et là, vous devenez victime, vous êtes paralysé, vous ne pouvez plus avancer.
À écouter : le podcast de la rédaction
Hollywood, écrivez-vous, vous a appris à ne jamais montrer que vous aviez besoin de quelque chose.
C’est la première règle. Après avoir décroché un petit rôle dans Dazed and Confused, presque sur un malentendu, je squattais chez le producteur du film, Don Phillips, à Los Angeles. Et tous les jours, je lui demandais : «Est-ce que tu pourrais me présenter un agent ? J’ai besoin d’un agent, j’ai besoin d’un rôle !» Il a vu mon anxiété, il m’a crié dessus : «Cette ville sent les gens qui sont dans le besoin, elle les rejette automatiquement ! Va-t’en, pars faire un voyage, va t’éclater avec tes potes, et reviens quand tu seras plus détendu !» C’est ce que j’ai fait. Quand je suis revenu, Don m’a organisé un rendez-vous. J’étais dans un autre état d’esprit. Je ne disais plus «J’ai besoin», mais «Je veux, j’aimerais». J’étais impliqué dans la conversation au lieu d’être impressionné. L’agent m’a signé un contrat le jour même.
L’autre leçon apprise à Hollywood est de ne jamais se vexer…
En tout cas, jamais dans le travail. Parce que lorsque vous avez du succès, tout le monde vous aime. Les gens vous le répètent plusieurs fois par jour, ils vous invitent à passer le week-end dans leur famille, vous appellent sans cesse, trouvent chacune de vos idées brillantes. Et puis, quand vous traversez une phase où vous avez moins de succès, les mêmes personnes ne décrochent même plus à vos appels. L’idée brillante n’a plus le moindre intérêt. Ça m’a fait du mal, au début. J’étais là : bon, donc ils m’aimaient car j’étais un bon produit sur le marché à cette époque. Eh bien, oui, c’est ça ! Et ce n’est pas grave ! Il ne faut pas le prendre de manière personnelle, c’est du business. Cela ne veut pas dire qu’ils ne pensent pas ces compliments. Cela veut dire que ces compliments s’adressent au choix industriel, financier, que je représente, pas à moi directement. Comprendre cela m’a aidé dans les passes difficiles, mais aussi dans les périodes de succès. Ça calme les choses, les remet à leur place.
En 2009, vous prenez une décision radicale : arrêter les comédies romantiques, pour chercher à intégrer des projets plus artistiques. Comment avez-vous géré ce virage ?
Cette décision est la plus personnelle de ma carrière. J’ai passé vingt mois dans le doute, sans travailler. On m’a adressé des dizaines de propositions de comédies romantiques. Des offres allant jusqu’à 14,5 millions de dollars. Mais j’avais fait un choix. Si je ne pouvais pas faire ce que je voulais, je refusais de faire ce que je ne voulais pas. Au bout de vingt mois, je m’étais résolu à changer de métier, arrêter le cinéma, et là, le téléphone a sonné ! C’est toujours comme ça dans la vie, il faut de l’endurance. On m’a proposé La Défense Lincoln, Bernie, Killer Joe, Paperboy, Mud, Magic Mike. Des rôles dont je rêvais, en cascade. Et puis est venu l’Oscar du meilleur acteur, pour Dallas Buyers Club. Ce film, j’essayais de le monter depuis des années, j’avais pris une option sur le premier rôle. Le scénario intéressait beaucoup de réalisateurs. Mais quand ils voyaient Matthew McConaughey, le type des comédies romantiques, dans le projet, ils passaient leur tour. Il a fallu du temps, le temps de changer mon image.
Vous racontez deux périples solitaires, au Pérou et au Mali, où vous êtes allé chercher, dites-vous, l’anonymat. Pourquoi ?
Quand vous êtes célèbre, le monde entier est un miroir. Chacun vous renvoie une image, vraie ou fausse. J’avais besoin de savoir qui j’étais vraiment. De mesurer ma valeur ou mon absence de valeur. Je me souviens des embrassades, des larmes, quand je suis reparti du Pérou. Cette amitié, cette lumière dans les yeux, elles étaient là pour le type qu’ils avaient rencontré. Personne ne savait que j’étais acteur. Il n’y avait pas de caméra, pas de plateau, pas de pouvoir, de question d’influence ou d’argent. Au Mali, j’ai dit que j’étais boxeur. On m’a proposé un combat contre un champion local. J’ai accepté, et j’ai tenu le choc, contre toute attente. Mais les gens là-bas m’ont dit : «On s’en fiche du résultat. Tu avais déjà gagné notre respect quand tu as accepté le défi.» Ça m’a beaucoup appris, cet épisode. Surtout quand tu viens des États-Unis, où il s’agit toujours de gagner ou de perdre. J’ai eu besoin d’aller chercher cette humanité-là.
(1) Greenlights, de Matthew McConaughey, Éditions du Seuil, 304 pages, en librairie le 7 octobre.
Source: Lire L’Article Complet